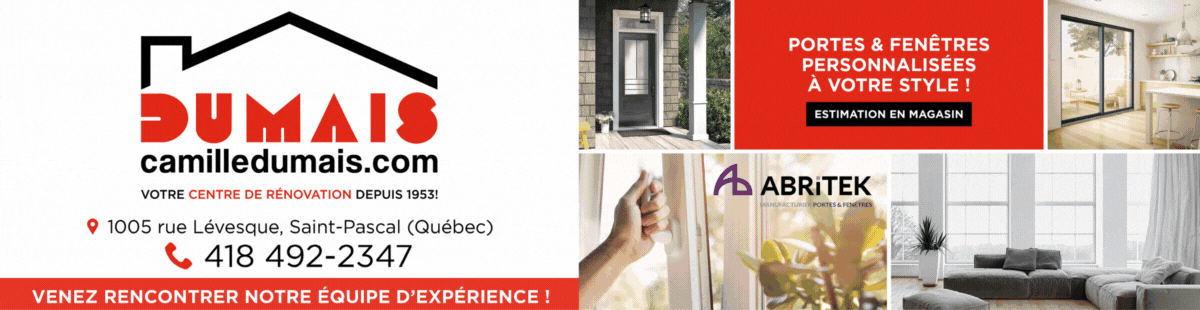Pendant que nos amies les anguilles, après avoir grandi discrètement dans nos rivières une vingtaine d’années, rasent les fonds et les battures du fleuve pour aller se reproduire et mourir dans la mer des Sargasses, voilà que nous arrivent ces jours-ci du Nord nos amies les oies blanches, en relais vers leurs quartiers d’hiver dans le Sud. Qui n’a pas ressenti un frisson au cri annonciateur de leur arrivée?
Ces dernières décennies, cependant, ça ne s’est pas très bien passé avec nos oies blanches. On leur a fait la guerre, une guerre un peu bête comme toutes les guerres, et elles nous ont en partie abandonnés.
D’abord, on nous a dit qu’après avoir failli disparaître au début du siècle et avoir été protégées grâce à une entente avec les Américains, elles étaient devenues trop nombreuses et qu’il fallait limiter leur reproduction, ce que la GRC a fait en aspergeant leurs nids dans le Nord avec un pesticide qui tue les embryons dans leurs œufs.
Ensuite, les cultivateurs leur ont déclaré la guerre, sous prétexte qu’elles dévoraient leurs semences et leur foin naissant au printemps. J’ai moi-même pu vérifier, sur la terre que j’ai cultivée pendant vingt ans au bord du fleuve, que ces présumés dommages étaient largement exagérés, sauf peut-être pour les blés ou seigles semés en automne, lesquels sont plutôt rares.
Non contents de réclamer et d’obtenir des compensations financières du gouvernement pour ces présumés dommages causés par les oies, les cultivateurs ont entrepris de les « effaroucher ». Pour les faire fuir de leurs champs, ils ont payé des « effaroucheurs » avec des fusils à blanc et des sifflets spéciaux, ils les ont soignées aux grains pour tenter de les confiner au nord de la route 132, et finalement, ils ont obtenu le droit de les chasser même au printemps sur leurs terres. Mais les oies sont brillantes et ont déjoué toutes leurs ruses. Il fallait les voir jouer à cache-cache avec les « effaroucheurs », dans un vacarme infernal de protestations.
Finalement, elles ont décidé d’aller ailleurs. Le printemps, elles préfèrent maintenant les régions du lac Saint-Pierre, du Lac-Saint-Jean et de Cacouna, où il reste des battures, et l’automne, elles se tiennent proche de leur site protégé de Cap-Tourmente, où on n’a pas le droit de les déranger. Au Kamouraska, elles se font de plus en plus rares, ce qui permet aux outardes de revenir, car les deux ne font pas bon ménage : les outardes sont discrètes et sauvages alors que les oies blanches sont bavardes et audacieuses, un peu folles même.
Ce que les cultivateurs et les riverains n’ont pas compris, c’est qu’ils sont les premiers responsables de l’envahissement de leurs terres. Les oies, à l’origine, s’arrêtaient au bord du fleuve pour se nourrir dans les battures et les milieux humides où poussent les scirpes et les spartines, dont les rhizomes font leurs délices et leur source de protéines. Or on achève de détruire ces marais salants pleins de vie, où se mélangent eau salée du fleuve et eau douce des champs. L’étalement urbain, industriel, agricole et villégiateur s’est prolongé jusque dans le fleuve. Et comme si ça ne suffisait pas, au Kamouraska, dans les années 1980, on a construit des aboiteaux qui ont asséché gratuitement pour les cultivateurs riverains des centaines d’hectares de ces marais recherchés par les oies blanches et bien d’autres oiseaux et poissons.
Alors nos amies les oies se sont repliées sur les terres en culture, puis quand on les en chassées, elles sont parties ailleurs. Nous voilà bien tranquilles… mais on s’ennuie d’elles maintenant. Pierre Perrault ne voyait-il pas en elles un symbole du peuple québécois, lui aussi acharné à survivre le long du Saint-Laurent, attaché à ce pays de froidure, et toujours prêt à fêter, à danser et à lutter?