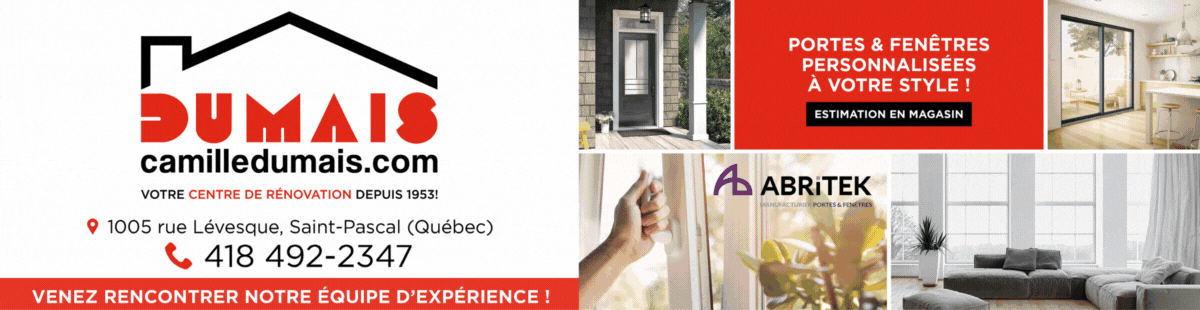Nos ancêtres étaient cultivateurs et aimaient la terre, LEUR terre. Des petites terres de 100 arpents — 28 de long et 3 et demi de large — qui leur permettaient de faire vivre leur famille. J’ai moi-même aidé mon père à défricher la nôtre.
En 1950, il y avait 150 000 fermes du genre pour nourrir quatre millions de Québécois. Chez nous, nous avions sept vaches, des cochons, des poules, des moutons, deux chevaux… et huit enfants. Il en reste moins de 30 000, dont 4500 fermes laitières, pour huit millions de Québécois. Dans le Centre-du-Québec, il y a maintenant plusieurs fermes de plus de 1000 vaches, et par ici, plusieurs passent de 80 à 400 vaches pour tenter de survivre.
L’UPA répète avec raison qu’il faut protéger nos terres, que les terres cultivables sont rares au Québec, qu’il faut refuser de les morceler ou d’y laisser construire de nouvelles résidences, que la zone agricole est notre garde-manger, une richesse collective. Mais le problème, ce n’est pas tant que nous manquons de terres cultivables. C’est plutôt que nous les utilisons mal. C’est que nous les surexploitons et ne les utilisons pas pour nous nourrir, nous.
Il y a présentement près de 50 % des terres cultivables qui sont en friche, surtout en régions périphériques, parce qu’elles n’intéressent plus les grosses fermes mécanisées et robotisées qui s’adonnent aux grandes cultures céréalières et aux élevages intensifs. Il n’est pas rare, même, qu’on les reboise tristement.
De plus, les bonnes terres qu’on cultive servent de moins en moins à nous nourrir, nous : notre taux d’autosuffisance alimentaire — il était de 80 % lorsque Jean Garon a quitté le ministère de l’Agriculture en 1986 — est descendu à 35 % depuis qu’on privilégie l’exportation et le libre-échange. Nos meilleures terres sont consacrées à la culture intensive de grains qu’on exporte ou qui servent à nourrir les animaux, surtout sept millions de porcs dont cinq millions (70 %) s’en vont à l’étranger. Et les tonnes de lisier qui restent ici surchargent nos terres et nos cours d’eau de nitrates et de phosphore.
Récemment, on nous apprenait que nous produisons désormais près de 50 % des fruits et légumes que nous consommons, sans doute grâce au développement de la culture en serre. Mais les fruits et légumes ne constituent que 15 % du panier d’épicerie. Heureusement, les produits laitiers, la volaille et les œufs que nous produisons sont réservés au seul marché québécois, grâce à la gestion de l’offre. Quant aux petites fermes maraîchères écologiques, qui vendent leur production localement, leur contribution est encore inférieure à 2 %.
On répète aussi que nos terres sont achetées par les Chinois, les banques, Pangea (groupe d’investissement agricole formé par l’homme d’affaires Charles Sirois, un proche de François Legault). C’est largement un mythe. On trouve peu de transactions avec les Chinois. Pangea n’a finalement formé que six petites corporations agricoles, avec de jeunes agriculteurs qui n’avaient pas les capitaux nécessaires pour développer leur ferme. Les banques, par contre, sont souvent les vrais propriétaires de nos terres, car les agriculteurs qui grossissent empruntent des sommes colossales. Quant aux terres en friche, elles sont souvent achetées par des urbains qui viennent s’établir en campagne.
Conclusion : il faut nous réapproprier nos terres pour nous nourrir. Si nous savons les utiliser localement pour nous nourrir, au lieu de privilégier l’industrialisation et l’exportation, nous n’en manquerons pas. Bien sûr, la Commission de protection du territoire agricole doit continuer à protéger la zone agricole contre l’envahissement urbain et résidentiel, mais surtout, elle doit s’assurer que nos terres cultivables servent d’abord à nous nourrir, nous !