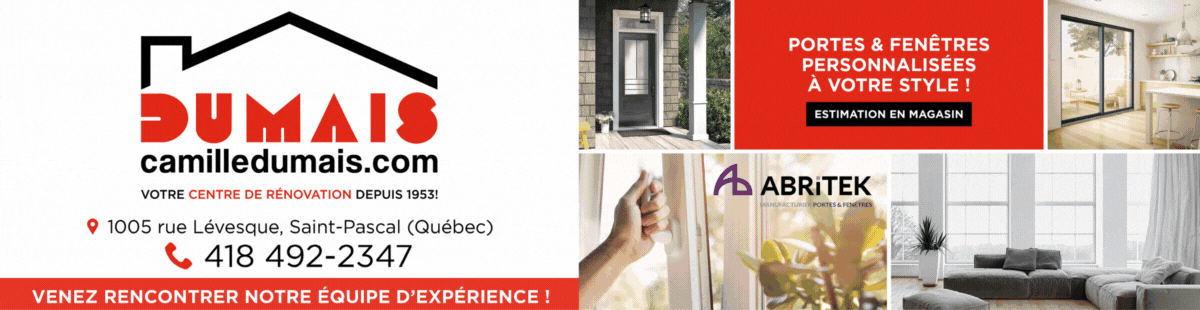Les défis dans le domaine agricole semblent n’avoir jamais été aussi importants. Entre les sécheresses qui se sont succédées durant quelques années au Bas-Saint-Laurent, la COVID-19 et maintenant la guerre en Ukraine, le président de l’UPA du Bas-Saint-Laurent Gilbert Marquis est d’avis que les gouvernements devront aider les agriculteurs. Tour d’horizon de ces enjeux en cinq questions.
Le Placoteux (LP) : 2021 semble avoir donné un répit aux producteurs agricoles du Bas-Saint-Laurent, après pratiquement cinq années de sécheresses consécutives. Comment s’annonce la prochaine saison ?
Gilbert Marquis (GM) : Dame nature sait mieux que n’importe qui ce qu’elle compte nous envoyer comme température au courant de l’été, mais avec la neige en abondance qu’on a reçue cet hiver, la fonte printanière va certainement permettre de faire le plein d’eau, ce qui n’est jamais mauvais pour le sol.
L’an passé a aussi été une bonne année pour les producteurs agricoles bas-laurentiens, en comparaison avec les précédentes. La plupart ont été capables de faire des réserves, même de vendre du foin. Quand on commence l’année et qu’on n’est pas en déficit, c’est encourageant pour la suite.
Après plusieurs étés de sécheresses, ça nous prenait vraiment une année comme celle-là pour voir la lumière au bout du tunnel. Les années précédentes étaient selon moi carrément catastrophiques.
LP : Ces sécheresses à répétition qu’on a vécues avant 2021, qu’est-ce que ça vous dit sur l’avenir de l’agriculture bas-laurentienne dans le contexte actuel des changements climatiques ?
GM : Il faut s’adapter, c’est sûr, mais à la base, les agriculteurs sont des gens qui ont une grande capacité d’adaptation. Par contre, un coup de pouce supplémentaire par le biais de programmes gouvernementaux serait apprécié.
On est habitué de semer toujours la même chose, comme le foin par exemple, parce qu’on sait aussi que ça réussit. Il existe sûrement d’autres alternatives qu’on pourrait mettre en terre et qui seraient moins fragiles aux sécheresses qu’on a vécu. Le hic, c’est que lorsqu’on sème quelque chose, ça prend toujours un an avant de voir les résultats. C’est pour ça qu’il faut être appuyé dans une démarche comme celle-là.
À l’échelle bas-laurentienne, on remarque aussi qu’on cultive davantage de maïs d’ensilage. Les superficies ont pratiquement doublé, voire triplé par endroit. Ça se comprend, car le maïs d’ensilage, il va chercher son eau en profondeur, donc il est moins victime des sécheresses. C’est peut-être une solution, mais il en existe sûrement d’autres qu’on pourrait mettre en application et qui nous aideraient dans le contexte des changements climatiques, mais de la recherche là-dessus, s’il s’en fait, on n’en voit malheureusement pas les résultats jusqu’à présent.
LP : Les travailleurs étrangers sont une réalité depuis plusieurs années dans le milieu agricole. Comment les producteurs bas-laurentiens envisagent la prochaine saison à ce chapitre, alors qu’on parle déjà de retard à l’Immigration depuis plusieurs années et que la crise en Ukraine risque d’amener son lot de dossiers de réfugiés à traiter ?
GM : On le crie sur toutes les tribunes depuis longtemps, il faut faciliter l’entrée des travailleurs étrangers, pas seulement pour le milieu agricole, mais pour tous les secteurs d’activités économiques, il manque de monde partout.
La situation en Ukraine, actuellement, c’est désolant, et on n’a rien contre l’arrivée de réfugiés ukrainiens au pays. Qu’est-ce qu’on peut faire en parallèle, par contre, pour aider les producteurs agricoles qui ont un besoin continu de main-d’œuvre étrangère ? Pouvons-nous accélérer le traitement des demandes ?
À l’UPA, ça fait des années qu’on le dit, c’est difficile de faire tourner la roue. Ce qui serait souhaitable, c’est d’accueillir ces travailleurs pour la saison des sucres, ensuite ils pourraient traverser chez les producteurs laitiers, faire les semis printaniers et demeurer pour la saison des récoltes à l’automne. J’espère que notre nouveau président national Martin Caron, qui lui a la chance de s’asseoir autour de la table avec les bonnes personnes, saura faire avancer ce dossier pour nous.
LP : Parlant de la guerre en Ukraine, ses répercussions sont multiples : augmentation du prix de l’essence, des engrais, des céréales… Qu’est-ce qui affecte le plus les producteurs bas-laurentiens actuellement ?
GM : Bien avant la guerre, on peut dire que la pandémie a déjà été très difficile pour nos producteurs. Les aides financières n’étaient pas conçues pour eux et ils ont été encore une fois les derniers à qui on a pensé.
Maintenant, la situation en Ukraine, c’est terrible à tous les niveaux. Une productrice de la région m’a confié qu’elle déboursait par le passé 70 000 $ en engrais chimiques. C’est année, à cause de la crise, c’est le double. Vous imaginez ? Ajoutez à cela le coût des semences, du diesel, de l’essence. Et le coût de vente des produits bruts de nos entreprises n’a pas augmenté tant que ça ! Il y a aussi certains producteurs pour qui la prime de l’assurance-foin a doublé, l’impact est majeur. Il faut aussi nourrir les animaux avec tout ça.
Maintenant que les commandes sont passées pour la saison, ça va prendre les sous pour payer et il y a sûrement des producteurs qui s’arrachent les cheveux de la tête en se demandant comment ils vont régler. Je le répète, ça va prendre des aides et on espère qu’on ne sera pas oublié par nos gouvernements (NDLR : l’entrevue a été réalisée le 22 mars au matin, avant le dépôt du budget provincial).
LP : Vous avez souvent fait de l’autonomie alimentaire du Bas-Saint-Laurent un de vos cheval de bataille. Croyez-vous qu’il est utopique d’y croire encore aujourd’hui ?
GM : Je vais toujours le souhaiter, le revendiquer. Il faut viser l’autosuffisance de notre territoire et le Bas-Saint-Laurent a déjà tout ce qu’il faut pour être autosuffisant sur le plan alimentaire. Ce qui nous manque, surtout, c’est les infrastructures en deuxième et troisième transformations, ou même des unités de réfrigération.
On travaille actuellement un projet d’abattoir mobile qui serait destiné aux animaux qui ont des faiblesses ou certaines problématiques et que les transporteurs ne veulent pas prendre. Une fois que les bêtes seraient abattues, elles seraient apportées à Luceville pour la découpe. C’est une solution parmi tant d’autres.
Dans l’ensemble, ça nous prendrait surtout beaucoup plus de petites infrastructures sur l’ensemble du territoire, bien faites et aux normes d’aujourd’hui, comme c’était le cas il y a 50 ans dans nos villages. Mais pour ça, il faut une volonté politique, un plan, des objectifs et des échéanciers si on veut que ça se produise. Autrement, dans 10 ans on sera encore là vous et moi à le souhaiter et rien n’aura avancé.