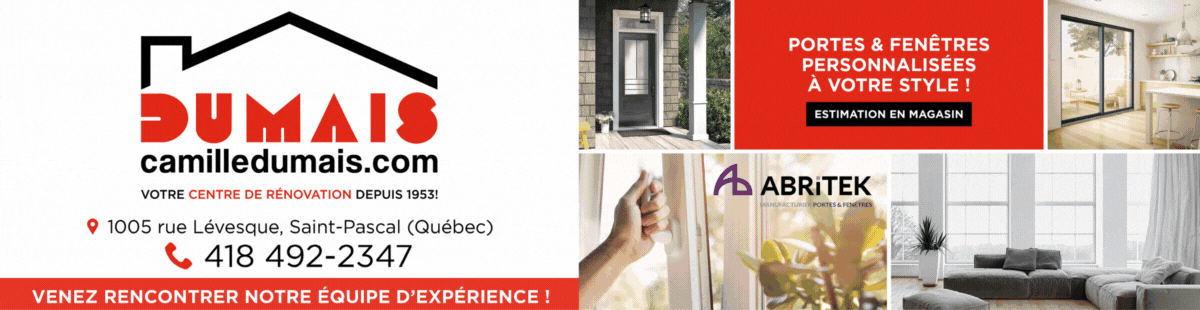Cette année, à Saint-Pacôme, l’été est ben beau. Des fois chaud, des fois mouillé, des fois frisquet, la nature a l’air d’aimer ça. Dans ma cour, ça verdoie solide. Ça faisait longtemps que mes tomates n’avaient pas eu l’air aussi heureuses, et j’ai mangé la première cerise de terre. Un 7 juillet, c’est tôt pour mon jardin.
Chacune de mes tournées d’inspection me montre des rocailles luxuriantes, des prés fleuris multicolores, des annuelles prometteuses (je les sème toujours trop tard). Les trois plants de bleuets débordent d’optimisme, la menthe se prend dans les lames de la tondeuse de mon voisin — qui s’en réjouit, parce que « ça sent bon en titi » —, et les fleurs de pavot répandent leurs taches roses dans tous les coins que les pensées sauvages n’ont pas envahis.
Bon, OK, la lavande trentenaire a perdu un peu de son lustre cette année, et le thym s’est éteint là où il luxuriait depuis des années. On ne peut pas toujours tout comprendre. J’ai ajouté du fumier de poule, du compost. La lavande a dit merci beaucoup et a ressorti son mauve. Le thym a dit regarde un peu plus bas, j’ai juste déménagé. Et c’est vrai, il est là, et il va très bien merci.
Gratitude, oui, mais…
Oui, vraiment, l’été est ben beau en haut de ma côte. Devant pareille abondance, je m’émerveille, des fois jusqu’aux larmes. Mais une p’tite gêne se mêle à ma gratitude. Une gêne légère, mais tenace.
Parce que, pas si loin de mon village, des forêts brûlent, des routes sont emportées par l’eau. Trop chaud en bas, trop de vent à côté. Le climat s’emballe, les ouragans se lèvent tôt, les morts meurent trop.
Ailleurs, il pleut des bombes, on migre plus vite que son ombre dans des pays qui se cachent derrière des murs. On rebâtit en catimini des dictatures qu’on croyait disparues à jamais. On promet la Lune, et même Mars, et les satellites se lancent à la chaîne. On prend tellement d’avions que les nuages se confondent avec les traînées blanches qui, si elles ne sont même pas chimiques, n’en disent pas moins long sur notre tête dure.
Moi, je marche dans le trèfle en fleurs pour voir si le chèvrefeuille va gagner sa guerre contre les pucerons. L’air sent le miel.
Mais la zénitude et la luxuriance de l’été n’arrivent pas à faire taire ce fichu lutin sur mon épaule, qui me répète, même quand je n’ai pas envie de l’entendre, que j’ai de la chance, trop de chance. Que je ne mérite pas vraiment la paix dans laquelle je baigne, et que la colère climatique va bien finir par me rejoindre en haut de la côte.
C’est pourquoi je me remplis de cette beauté, pour la porter en moi tant qu’elle durera, et surtout après. Je regarde, de tous mes yeux je regarde, comme Michel Strogoff avant que le sabre chauffé à blanc ne lui enlève la vue. Mais contrairement à la saga de Jules Verne, je ne crois pas que mes larmes changeront quelque chose à la fin de l’histoire.
Serais-je écoanxieuse?