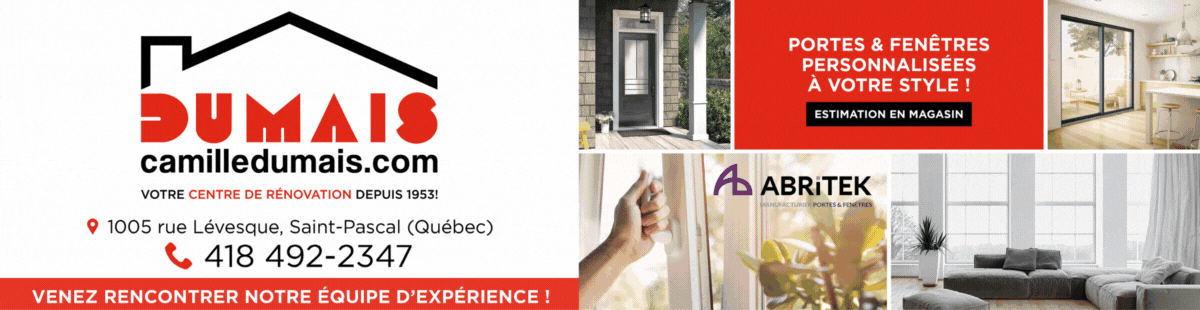Vue du ciel, notre planète Terre est bleue, parce qu’elle est majoritairement couverte d’eau et entourée d’une atmosphère composée d’azote et d’oxygène, deux composantes essentielles de la vie. Pour nous qui l’habitons toutefois, c’est une planète verte, parce qu’elle est couverte d’une végétation luxuriante qui y entretient la vie. C’est une planète végétale.
Elle risque cependant de devenir brune ou rouge et inerte comme Mars, car nous sommes en train d’emplir l’atmosphère de carbone, d’empoisonner les océans et de raser les espaces verts et les forêts. Ce faisant, nous risquons de rendre la vie difficile ou impossible, la vie humaine du moins, plus fragile parce que plus complexe.
La pression que nous exerçons sur l’eau, les sols, les ressources minérales, la végétation et la forêt s’est considérablement accrue depuis l’avènement du libre-échange mondial à la fin du siècle dernier. Pour exporter nos ressources, nous sommes prêts à les épuiser et nous créons des entreprises et des villes de plus en plus grosses et de plus en plus concentrées pour y parvenir. C’est aussi vrai chez nous au Québec.
Prêts à tout pour exporter !
Notre industrie forestière exporte 60 % du bois qu’elle coupe, et pour exporter toujours plus, elle tasse les Premières Nations, les caribous, les érablières, les aires protégées… et les acériculteurs.
Nos acériculteurs, de leur côté, exportent 75 % de leur sirop, de plus en plus industriel et standardisé, et convoitent, tout comme les industries forestières, les érables situés sur les terres publiques pour augmenter leur nombre d’entailles. Les usines de bouillage remplacent les cabanes à sucre.
Nos agriculteurs, ou plutôt les intégrateurs et les banques qui les financent, exportent 75 % des huit millions de porcs qu’ils produisent, et pour les nourrir, ils agrandissent sans cesse les espaces consacrés aux monocultures de céréales à grand renfort d’engrais, de pesticides et d’OGM qui endommagent les sols vivants, sans compter la charge considérable de phosphore contenue dans les lisiers qui saturent nos cours d’eau et les asphyxient. Heureusement, la production laitière échappe encore — mais pour combien de temps — à cette folie des échanges, même si elle n’échappe pas à la folie de la concentration et à la mainmise des banques.
Nos pêcheurs, de plus en plus concentrés eux aussi, exportent 81 % des fruits de mer qu’ils récoltent, lesquels sont de plus en plus menacés par la surpêche et le réchauffement des océans.
Hydro-Québec, maître d’œuvre de notre production d’énergie, exporte aussi de plus en plus son électricité « propre » et rêve de devenir la « pile » énergétique de l’Amérique : d’autres barrages, parcs éoliens et solaires, chantiers d’hydrogène vert sont à prévoir… à quel prix ?
Quant à nos mines, nous savons tous que nos précieux minerais non renouvelables du bouclier laurentien et du Labrador sont massivement exportés à l’état brut pour moins que rien et transformés ailleurs avant de nous revenir en produits finis. Et que dire de l’aluminium pour laquelle nous donnons quasiment notre électricité et des bassins hydrauliques aussi précieux que le Lac-Saint-Jean lui-même.
L’exportation crée bien sûr des emplois, fait rouler l’économie et enrichit les plus gros. Mais cette compétition et cette course à l’exportation, à la production, à la consommation et à l’argent risquent de détruire ce qui permet chez nous à la vie, et aux humains plus particulièrement, de survivre et de grandir. Peut-être devrions-nous songer à revenir à plus d’autonomie locale et régionale, à l’économie circulaire. Le village et le quartier ont peut-être plus d’avenir que la ville, le marché de proximité plus que le libre marché, les communautés autonomes et durables plus que les grands centres.