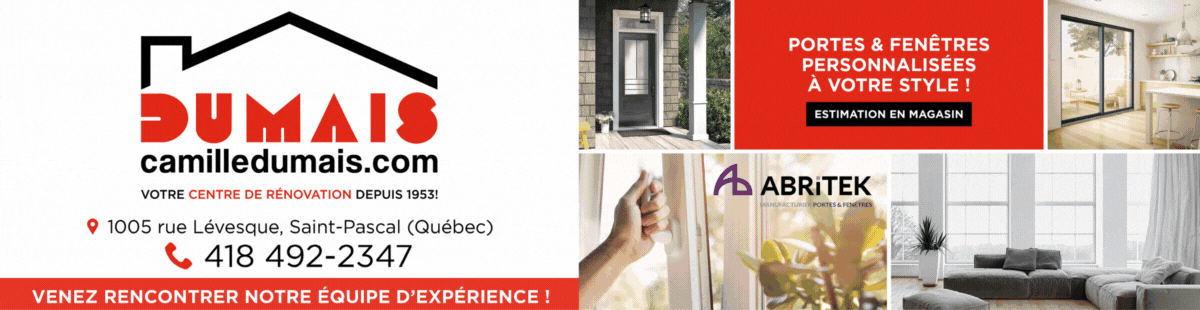L’équipe de rédaction du Placoteux a désigné Chantal Caron comme personnalité de l’année. Chorégraphe visionnaire et réalisatrice audacieuse, cette grande artiste a su faire rayonner Saint-Jean-Port-Joli et le Bas-Saint-Laurent bien au-delà de nos frontières. À travers son œuvre, où la danse contemporaine rencontre la nature, Chantal nous invite à redécouvrir le majestueux fleuve Saint-Laurent, ce géant que nous côtoyons chaque jour sans le connaître vraiment.
Ses créations, profondément enracinées dans notre territoire, ont touché des publics partout dans le monde. Avec son talent et sa détermination, Chantal Caron a transformé le fleuve en une scène vivante, où la danse devient un dialogue entre l’humain et l’immensité naturelle. Une personnalité inspirante, ancrée dans sa communauté, qui incarne à la perfection l’esprit créatif et résilient de notre région.
Le Placoteux : Vous avez été sélectionnée comme personnalité de l’année. Qu’est-ce que cela vous fait d’être reconnue par les gens de votre région?
Chantal Caron : Un prix reçu de notre communauté a toujours un écho et une résonance très forts, parce que c’est comme le clan qui te reconnaît. Tu deviens tout d’un coup importante à leurs yeux. Une reconnaissance internationale consolide l’idée que ton travail est bon, mais l’aspect communautaire d’un prix chez soi, c’est vraiment un baume sur le cœur.
LP : Parlez-nous de votre enfance à Saint-Jean-Port-Joli.
CC : Je suis née aux Trois-Saumons. On était quatre enfants : deux frères jumeaux, une petite sœur arrivée huit ans plus tard, et moi. Le village était très inspirant. Il y avait des sculpteurs, des peintres, et les œuvres des Bourgault suscitaient une grande fierté chez les gens. Tout ça m’a influencée artistiquement.
Il n’y avait pas de danse, mais ma mère m’a inscrite au judo dès l’âge de huit ou neuf ans. Au départ, je n’aimais pas cette activité, mais j’en ai fait jusqu’à ma première année de cégep. J’ai aussi fait beaucoup de natation, ce qui m’a permis de développer confiance, force et souplesse.
Le fleuve était omniprésent. Nous habitions à une trentaine de pieds de l’eau. Je me souviens de mon enfance près du fleuve comme d’un mélange de fascination et d’inquiétude. Nous habitions dans une petite maison si près de l’eau que j’avais parfois l’impression que celle-ci allait m’avaler. Je passais des heures à jouer sur les rochers, leur donnant des noms, et recréant un monde adulte en miniature : une cuisine ici, un salon là… Il y avait même la roche de la danse. J’étais dans mon univers, à la fois émerveillée par cette nature immense, et un peu effrayée par ce qu’elle représentait.
La nuit, cette proximité devenait encore plus palpable dans mes rêves. Je partageais ma chambre avec ma petite sœur Sonia, et ma peur, c’était souvent de me réveiller le matin et que mon lit flotte sur le fleuve, dérive avec les glaces. Ces peurs se sont transformées en source d’inspiration. Mon premier film, Glaces, crevasses et dérives, est directement né de ces rêves d’enfant. Il raconte l’histoire d’une petite fille qui dérive sur le fleuve Saint-Laurent.
L’éveil à la danse
LP : D’où vient votre passion pour la danse?
CC : Dès que j’ai pu regarder la télévision, j’ai été fascinée par Fred Astaire et Ginger Rogers, et j’étais convaincue que c’était ça que je voulais faire. Il y avait aussi Gene Kelly et des films de nage synchronisée qui m’ont marquée, et ça a teinté mes chorégraphies. C’était surtout la comédie musicale qui me passionnait. Très jeune, je voulais être artiste, différente.
LP : Comment s’est déroulée votre formation en danse?
CC : J’ai fait mon cours classique au collège Sainte-Anne. J’ai beaucoup aimé cette école. Ensuite, j’ai envisagé une technique en assistance sociale, je voulais faire la médecine, mais j’ai vite changé d’avis. J’ai vraiment découvert la danse au cégep, où j’ai suivi de nombreux cours. C’est à Trois-Rivières que j’ai commencé la technique Simonson avec Claire Maillé. Elle m’a encouragée à me lancer pleinement dans la danse. À Montréal, j’ai multiplié les auditions, et même si je n’avais pas de technique, j’ai obtenu des bourses dans plusieurs écoles, notamment chez Louise Lapierre. J’y ai appris la danse moderne, la claquette. Finalement, j’ai été acceptée à l’Université de Montréal pour un programme en danse. C’était un rêve devenu réalité.
Cette même année — en 1981 — à 21 ans, je me suis retrouvé en compagnie d’une quinzaine de danseurs avec l’Office franco-québécois pour la jeunesse, pour visiter des centres chorégraphiques en France. J’ai alors rencontré la chorégraphe Maguy Marin, dont le mouvement m’a beaucoup inspiré. Les différents courants de danse — classique, contemporaine et moderne — ont alors forgé les racines de ce que j’allais devenir.
Fleuve Espace Danse a été fondée en 2006, mais ma reprise de la danse professionnelle date de 2001. À cette époque, c’était une période charnière. Une interprète enceinte m’avait demandé de la remplacer dans une production. C’est là que je suis retombée en amour avec l’interprétation. Cette expérience m’a menée à la rencontre de Johanne Dor, directrice du Centre chorégraphique de Québec, qui m’a ouvert les portes du Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ).
Ouvrir une école de danse à cette époque-là, c’était un peu prétentieux. J’avais 26 ans. À mes débuts, je jonglais avec deux réalités : ma compagnie professionnelle, Fleuve Espace Danse, et l’école de danse. Ce n’était pas simple de mener ces deux projets de front. Mon entourage m’a encouragée à me concentrer sur l’école, ce qui m’a permis de transmettre les valeurs auxquelles nous tenions tant : l’estime de soi, la force intérieure et le respect de soi et des autres.
LP : À cette époque, la danse était en concurrence avec des activités comme le hockey?
CC : Oui, tout à fait. Je voyais beaucoup de petites sœurs suivre leurs frères au hockey. Au fil du temps, nous avons réussi à faire en sorte que la danse devienne aussi une source de fierté pour les familles. Aujourd’hui, voir nos filles briller est un réel plaisir. L’école s’est toujours démarquée, remportant de nombreux grands prix depuis ses débuts.
De la scène aux films
LP : Comment en êtes-vous venue à faire des films?
CC : C’est avec Marie-Claude Gamache que l’idée a germé. Elle est chorégraphe, et travaille dans le domaine de la danse contemporaine.
Elle m’a suggéré de travailler sur le thème de l’hiver dans un film : comment le corps réagit au froid, un sujet qui résonnait avec notre quotidien hivernal. Nous avons déposé un projet au CALQ, et nous avons obtenu une bourse. J’ai fait venir deux danseurs à Saint-Jean-Port-Joli. Nous avons eu la chance d’avoir une tempête de neige lors du tournage. Pendant quelques jours, nous avons tourné des images, sans envisager d’en faire un film. C’est Richard Saint-Pierre, mon directeur photo, qui m’a encouragée à soumettre ces images au Festival international des films sur l’art (FIFA).
C’est ainsi qu’un nouveau chapitre s’est ouvert pour moi : celui de la réalisation de films sur la danse, toujours en lien avec la nature. Cela m’a permis de prolonger la portée de la danse, et de toucher un public plus large, ce qui n’était pas toujours facile avec les performances en direct.
Une transmission de savoir essentielle
LP : Vous avez collaboré avec des experts pour perfectionner vos films. Comment cela s’est-il passé?
CC : J’ai eu la chance de travailler avec Albert Girard, un retraité de Radio-Canada, qui m’a enseigné les bases du scénario et des rouages du cinéma. Au départ, je pensais que la chorégraphie suffisait à faire un film, mais il m’a montré que c’était bien plus complexe. Ces échanges ont enrichi ma démarche, et m’ont aidée à trouver un équilibre entre l’expression artistique et les exigences techniques du cinéma.
LP : L’idée du film Marée noire est née d’un événement marquant. Pouvez-vous nous en parler?
CC : L’idée première de Marée noire remonte à 2013, lors de la tragédie du déraillement du train à Lac-Mégantic. Cette catastrophe humaine et environnementale a été bouleversante. À l’époque, je n’étais pas prête à en parler, ou à en témoigner à travers le mouvement. À la place, j’ai travaillé sur un autre projet, Sédimentation, qui a donné lieu au spectacle Homme de vase.
Ce n’est que bien plus tard, en 2019, que j’ai revisité l’idée de Marée noire. Ce projet s’est vraiment ancré dans l’urgence de parler de cette tragédie humaine et environnementale, mais avec la distance émotionnelle nécessaire pour le faire avec authenticité.
LP : Pourquoi le fleuve Saint-Laurent est-il un lieu si central dans votre travail?
CC : Parce que c’est mon territoire, mon lieu d’enfance. Le fleuve fait partie de qui je suis. Par exemple, lors du tournage de Prendre le Nord en 2017, j’ai réalisé à quel point ce territoire m’habite. On a tourné sur les berges du fleuve, et c’était une évidence pour moi de rester fidèle à cet environnement.
En 2016, j’étais revenue du Groenland avec des images et des souvenirs à couper le souffle, et j’ai voulu partager cette expérience à travers le spectacle Le souffle de l’aube. La dernière scène de ce spectacle s’appelait La marée noire, où une grande robe noire symbolisait le thème. C’est cette séquence qui a inspiré la première partie du film. En 2019, il y a eu aussi le court métrage Clémentine, qui a fait le tour du monde et a remporté plusieurs prix.
Les défis des tournages hivernaux
LP : Vous avez évoqué plusieurs lieux et saisons pour le tournage de Marée noire. Comment avez-vous géré les contraintes liées à ces choix?
CC: Le tournage hivernal sur les glaces du fleuve Saint-Laurent a été un défi technique et logistique. Par exemple, après le premier tournage en février 2020, nous sommes tombés en pleine pandémie. J’ai ressenti le besoin de continuer à créer malgré tout. Avec mon équipe, nous avons acheté de l’équipement pour être autonomes, et sommes partis explorer la Côte-Nord : Baie-Sainte-Catherine, Les Escoumins, et les dunes de Tadoussac. Ces paysages ont ajouté une dimension unique à la deuxième partie du film.
LP : Marée noire a donc évolué sur plusieurs années.
CC : Ce film s’est construit dans la durée et dans la réflexion. En collaborant avec Joël Bêty, un chercheur biologiste spécialisé dans les oies blanches, j’ai découvert des éléments fascinants qui ont nourri ma chorégraphie. Par exemple, l’idée du cou rouge des oies m’a inspiré des mouvements spécifiques, comme le picotement des doigts sur le cou des danseurs.
LP : Sur quels projets travaillez-vous?
CC : Actuellement, nous travaillons beaucoup sur la disparition du caribou. Ce projet s’est développé en collaboration avec le Petit théâtre du Vieux Noranda et Rosalie Chartier-Lacombe, une artiste et une collaboratrice extraordinaire. C’est elle qui m’a sensibilisée à la problématique de la disparition des caribous dans son coin, à Rouyn-Noranda, et en Gaspésie. Pour moi, qui suis une fille du fleuve, cette question était très éloignée, mais Rosalie, une femme de la forêt, m’a ouverte à cette réalité. Nous avons beaucoup échangé, et rencontré des gens passionnés par le caribou, qui connaissent intimement cet animal sur son territoire.
Pour moi, il était essentiel de lier mon fleuve et la mémoire vivante de l’eau à l’esprit du caribou. Ce lien m’est souvent soufflé par mes rêves. Dans ce cas, c’est l’image des bois de grève qui m’a marquée. Chaque printemps, de nombreux bois de grève s’échouent chez nous, et lorsqu’ils sèchent en été, ils m’ont évoqué des panaches. Cette découverte a donné du sens à mon projet.
LP : Ce projet vous a-t-il amenée à explorer d’autres horizons?
CC : Il y a eu un appel de résidence en Norvège, à Oslo, auquel nous avons répondu. Nous avons été sélectionnés, et par un heureux hasard, mon film était aussi présenté au Festival Red à Oslo.
Je suis allée au printemps. J’ai fait un repérage avec Julia Perron Langlois, une ancienne collaboratrice originaire de La Pocatière qui vit maintenant à Montréal. Nous avons une relation de travail formidable, même après toutes ces années. En septembre, nous sommes retournées en tournée avec quatre interprètes, que j’appelle mes « femmes caribous » ou mes « caribounes ».
Les paysages que nous avons explorés là-bas étaient d’une beauté à couper le souffle. J’en suis encore bouleversée. Nous avons pris le temps de nous connecter avec les communautés nordiques qui nous ont accueillies. Ce lien humain est toujours essentiel dans mes recherches.
Je n’ai pas encore eu le temps de visionner toutes les images capturées durant ce voyage, mais je sais que ce projet a une portée immense. Il transcende le simple fait artistique pour devenir une réflexion sur nos liens avec la nature et les autres.
LP : Est-ce que nous aurons droit à un autre spectacle ici à l’été 2025?
CC : C’est encore en gestation. Ce qui est certain, c’est que je vais continuer à explorer le thème de la mémoire des eaux. Le spectacle s’appellera Le retour des baigneuses. L’idée est d’aller des éléments les plus infimes, comme le plancton, jusqu’aux plus majestueux, comme les baleines. Esthétiquement, je veux m’inspirer des années 50, avec les maillots rétro et les casques de bain, une imagerie qui me rappelle mon intérêt pour les nageuses synchronisées.
LP : Avez-vous un souhait à partager?
CC : Mon plus grand souhait est de conserver ma santé et l’énergie nécessaire pour continuer à créer, notamment des films. Ces projets me permettent de voyager, d’explorer d’autres cultures, paysages et façons de vivre. Chaque rencontre nourrit mon regard et bouscule ma vision du monde.
LP : Vous avez mentionné à plusieurs reprises l’importance des liens familiaux dans votre parcours…
CC : La famille est absolument centrale dans tout ce que je fais. Je n’aurais pas pu développer tout cela sans le soutien indéfectible de mon mari, Jean. Il a été un partenaire extraordinaire, un conjoint merveilleux, et un papa très attentionné. Depuis le tout début, quand j’ai décidé d’aller faire de la danse à Montréal, je lui ai demandé s’il voulait me suivre, et il a accepté. Il m’accompagne depuis presque 50 ans, depuis notre adolescence. C’est un pilier dans ma vie personnelle et professionnelle.
Mes enfants jouent aussi un rôle crucial dans ma vie. Depuis presque dix ans, ma fille Emie-Liza Caron St-Pierre est directrice générale de Fleuve Espace Danse. Ça fait toute la différence dans un milieu aussi exigeant. Nous avons une belle complémentarité.
Mon autre fille, Éléonar, est directrice de l’École de danse Chantal Caron. Elle a repris l’école, et continue d’y transmettre les valeurs que nous avons toujours portées. Angélique, une autre de mes filles, est recherchiste sur des plateaux télé à Montréal, mais cet été, elle a été coordinatrice pour l’un de nos projets. Luka, mon fils, est propriétaire de Peinture Loa. Il nous aide souvent en tant qu’assistant technique ou animateur d’ateliers de médiation culturelle.
LP : Un dernier mot pour nos lecteurs?
CC : Merci pour ce privilège de parole. Ce n’est pas donné à tout le monde d’avoir une tribune dans un journal, et j’en suis profondément reconnaissante.