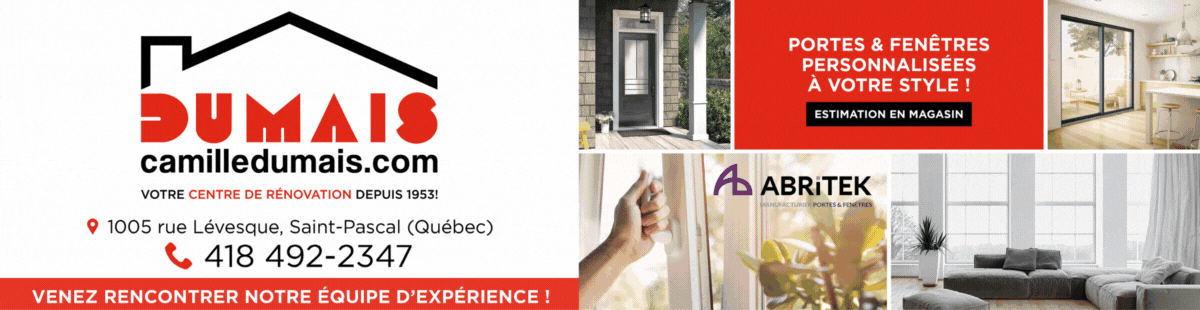Il chasse le chevreuil depuis qu’il a 15 ans. Il en a 63. Pour tout ce qui vient autour : la préparation, les repérages, les caches, l’attente, le silence, la patience. Sylvain Cazes de La Pocatière parle de la chasse comme d’une passion, du printemps jusqu’aux premiers froids. Le 7 août 2025, cette routine a failli se terminer net au pied d’une épinette, après une chute de 25 pieds d’un mirador improvisé.
Sa chasse préférée, c’est le chevreuil. Une activité plus solitaire, plus fine que celle à l’orignal. « Au chevreuil, tu peux te débrouiller seul, sans déranger. Tu es capable de faire tes affaires sans besoin de demander d’aide de personne », dit-il, citant des souvenirs de chasses mémorables. « Les plus beaux que j’ai tués, c’était à l’arc, à 15 pieds, 20 pieds. Très proches. »
À 63 ans, malgré les années, les accrocs et quelques incidents, il n’a jamais cessé de chasser. Il était déjà tombé d’un arbre, au Cap Martin, mais ça n’avait rien à voir avec ce qui lui est arrivé cet été.
Préparer le terrain
Le 7 août au matin, il part pour préparer le terrain d’une éventuelle chasse. L’endroit est situé entre Saint-Damase et Tourville, dans une zone sans chemin direct. « Sans GPS, ce serait facile de se perdre. L’endroit est loin des routes, avec seulement deux chemins accessibles à environ 25 minutes de marche. » Sylvain est seul. Personne ne sait qu’il est parti, encore moins où il est.
Il monte une première plateforme à environ 15 pieds, mais veut monter plus haut. « C’est pour que le chevreuil ne puisse pas te sentir. Il a un excellent odorat. Plus tu es haut, moins il peut te sentir », explique-t-il. Armé de ses outils, sa scie, de l’eau, tout dans son sac à dos, il choisit une épinette. Il se dit que ce sera parfait.
Normalement, pour ce genre de projet, il pourrait utiliser un trépied commercial. Mais les trois qu’il possède sont déjà installés ailleurs, et il ne veut pas en acheter un autre. Il décide donc de se fabriquer une plateforme maison. Ainsi, il coupe de belles épinettes, fait des supports en forme d’Y, installe des vis, prépare tout au sol, et monte le matériel.
Ascension et chute
Pour grimper, il utilise des crochets en métal vissés dans l’arbre, espacés aux 12 pouces, comme une échelle. « Les crochets sont solides. C’est super sécuritaire. » Sylvain Caze connaît la routine. Il sait exactement quoi faire. « Normalement, tu t’attaches avec un harnais. Tu t’attaches en arrière de toi, près de l’arbre. Avec l’attente, le silence, la fatigue s’installe, tu te mets à cogner des clous, tu t’endors et tu peux tomber face première au sol », illustre-t-il. Il connaît le danger. Malgré cela, il ne s’attache pas.
Il s’exécute avec sa plateforme maison, et s’affaire sur une grosse vis qu’il pourrait, se dit-il, entrer plus creux dans l’arbre. Il met le pied sur le crochet du dessous, commence à visser, et tout lâche. « Je me suis senti partir avec tout le stock sur le dos. »
La chute est brutale. Vingt-cinq pieds, c’est environ 7,6 mètres, l’équivalent d’un immeuble de deux étages. Lui, il compare ces 25 pieds à la hauteur des transformateurs d’Hydro-Québec. « Ce que je me suis dit quand je me suis senti tomber ? Ça va faire mal en tabarn… »
Sylvain s’écrase au sol. Il insiste sur un détail qui, selon lui, a fait la différence entre la vie et la mort. « J’avais tout nettoyé le site au sol, beaucoup plus que d’habitude. Souvent, on coupe vite, on laisse des petits pics, des troncs pointus. Cette fois, j’avais tout ramassé, nettoyé, fait une zone plus “propre”. C’était comme un beau lit de mousse. » Sans cela, il est convaincu qu’il aurait pu s’empaler.
Quand il touche le sol, il croit qu’il vient de mourir, ou que ça s’en vient. « J’étais certain que j’étais cassé de partout, que j’avais une hémorragie interne. C’était impossible de bouger, de me relever. Mon corps ne répondait plus. J’étais mou comme un jello. » Il ne panique pas, mais se parle intérieurement. Il est loin. Personne ne l’entendra s’il crie. « Personne ne sait où je suis. Je suis pogné ici, personne ne peut venir m’aider. Je suis fait. C’est ici que ça finit. »
Il voit un trou profond de deux pouces dans sa cuisse. Un crochet vissé sur l’arbre lui avait transpercé la peau lors de sa chute. « Le crochet est rentré et ressorti. Ça a fait un méchant trou et ça saignait. » Sylvain Cazes reste là, environ une demi-heure, à se dire qu’il va mourir. Il pense à sa vie, se dit que les gens vont dire qu’il est mort en faisant ce qu’il aimait. »
Puis il tourne la tête. Il voit son cellulaire, à côté de lui. Tombé tout près. Il n’en revient pas. Le réflexe est presque désespéré : il faut l’atteindre, même s’il est persuadé qu’il n’y a pas de réseau sur ce site. « Je le sais, je l’avais déjà essayé, il n’y a rien qui entre ». Il entreprend tout de même de le saisir. Il rampe par petits coups, millimètre par millimètre, en s’agrippant à la mousse. La douleur est insupportable. Finalement, il attrape son téléphone, compose 911… et ça répond !
« Je suis tombé en haut d’un arbre à peu près à 25 pieds de haut. Je suis cassé en morceaux, je ne suis plus capable de bouger. Je suis tout seul ici », dit-il à la répartitrice, qui cherche sa position, mais ne le voit pas sur la carte. Et la ligne coupe. Et Sylvain replonge dans le noir. « Là, j’ai dit, c’est vrai que c’est la fin. »
Une heure plus tard, le téléphone sonne à nouveau. Cette fois, la voix est claire : la répartitrice l’a localisé. « Les secours s’en viennent. J’ai trouvé votre téléphone sur ma carte. J’ai pris le GPS de votre position, et l’ai transmise aux pompiers. » L’espoir revient.
Dans le bois, il entend des bruits. Des portières de VTT, des voix, des cris. Et quand les premiers répondants arrivent, le choc est double : ce sont des collègues. « Ah ben cr… c’est Sylvain », lui lancent-ils. Deux confrères de travail, pompiers volontaires. Ce hasard additionné au reste, il ne l’explique pas autrement que par une présence. « Mon père. Tout le monde me dit que c’est un miracle. Mon père était là, en haut. Je ne devais pas mourir ce jour-là. »
Tout s’entremêle, incluant les douleurs atroces. Il implore les ambulanciers de ne pas le bouger n’importe comment. Attaché sur une civière, la longue sortie du bois commence. « C’était un calvaire, dans la bouette, les souches, les trous. J’ai été échappé plusieurs fois. À chaque secousse, la douleur était inimaginable. » Malgré tout, il répète la même phrase, comme une prière : « Merci les gars. Vous m’avez sauvé la vie. »
Au bout de cette journée, Sylvain Cazes comprend une chose. Il est vivant, mais est passé à un cheveu de ne jamais revenir. Et s’il a un message, il n’est pas compliqué. « Dire où on va, ne jamais partir seul, sans avertir, et surtout, s’attacher. Toujours. » La suite s’est écrite à l’hôpital. Et elle est tout aussi dure.
Le long retour vers une vie normale
Sur une civière, après un parcours jonché d’obstacles en plein bois, Sylvain Cazes et ses sauveteurs arrivent à l’ambulance. Il est vidé. La douleur est indescriptible. Il a tenu le coup sans médicaments, encaissant chaque choc sur la civière dans les souches et la boue. Et quand les ambulanciers lui disent qu’ils vont enfin pouvoir lui donner quelque chose, il exige quelque chose de fort.
« Ils m’ont donné du fentanyl ! Je peux vous dire que ça marche très fort. Je n’avais plus rien, je ne sentais plus rien. » Rien, sauf un calme artificiel, celui qui arrive quand la douleur décroche enfin. Direction Montmagny. À l’hôpital, on le transfère, on le manipule, on le passe d’une table à l’autre. Il remarque tout, même ces détails, parce que chaque déplacement le fait atrocement souffrir. On le radiographie, on l’évalue. Et très vite, la conclusion tombe : ce n’est pas un cas ordinaire. On l’envoie à Québec. « On vous transfère à l’Enfant-Jésus. Vous êtes polytraumatisé. »
À l’Enfant-Jésus, le diagnostic est lourd. Il le répète comme on énumère une liste qu’on n’aurait jamais voulu entendre. « J’avais le bassin cassé en deux, la hanche, quatre côtes, la clavicule, j’avais mon gros trou dans la jambe, et l’épaule disloquée. » Nous sommes jeudi. Malgré l’urgence, il ne sera pas opéré avant le mercredi suivant. Le spécialiste a besoin d’un bloc opératoire durant cinq heures. Coincé sur son lit, il attend, avec des piqûres aux trois heures. Il les prend toutes. « Je n’en sautais pas une. »
L’opération dure cinq heures. Il sort de là sans vraiment savoir ce qu’ils ont fait. Il n’a pas posé de questions. Il était dans un autre monde. Mais la réponse, il la résume en une phrase qui revient souvent. « Ils m’ont mis des vis partout. Je suis tout vissé », dit-il, montrant une photographie d’une radiographie qui ne laisse aucune place à l’interprétation. « L’arrière de mes hanches ne bouge plus comme avant. Là où il y avait des ligaments, tout est maintenant fixé. »
Difficile processus de réhabilitation
Sylvan Cazes passe un mois à l’Enfant-Jésus, sans jamais se lever, sans air climatisé, sans télévision. Le temps est long à attendre le moment où l’on commencera à lui montrer comment redevenir fonctionnel. Quand on l’installe enfin en fauteuil roulant, il sent que la sortie devient possible. Mais rentrer chez lui n’est pas simple : il vit dans un trois et demi au troisième étage. Impossible. On l’oriente vers la réadaptation. D’abord un transfert temporaire à La Pocatière, faute de place, puis à Saint-Antonin, dans un ancien foyer devenu centre de réadaptation. Et là, nouveau coup dur.
À La Pocatière, il fait une forte fièvre. Son corps rougit. Il fait 40 degrés de fièvre. Une infirmière s’inquiète et tranche. Retour à Québec.
On suspecte une infection. De fait, une bactérie s’était introduite dans son corps lors de l’opération. Les médecins l’ont traquée, coincée, tuée.
Sylvain retourne vers la réadaptation à Saint-Antonin. Au départ en fauteuil roulant, puis avec des béquilles. Il avait déjà connu la rééducation, parce qu’il avait eu un autre accident majeur plus jeune : un face-à-face en moto avec une voiture, fracture ouverte, fémur sorti. Il en parle sans détour, comme pour dire que son corps a déjà été mis à l’épreuve. Malgré tout, cette chute de 25 pieds reste un sommet de douleur.
En réadaptation, son moral descend. « La nourriture n’était pas mangeable. J’ai perdu 27 livres. » Il finit par imposer son menu de survie : soupe, yogourt, jello, café. Puis, il peut enfin rentrer chez lui avec un suivi tous les deux mois. « J’ai dû attendre douze semaines pour la consolidation avant de mettre du poids. Lorsque j’ai pu me lever, j’ai demandé à voir mes radiographies pour comprendre ce qu’on m’avait fait. » Il est frappé. « Quand je montre ces images aux gens, ils me demandent comment je fais pour être encore debout ».
Douleur permanente
Aujourd’hui, il vit avec une raideur permanente. Il fatigue vite debout, supporte moins longtemps les positions, il doute de pouvoir retourner à son travail comme avant. Il parle de ses démarches : chômage maladie, rencontre avec l’orthopédiste, assurance salaire, incertitude. Il ne dramatise pas. Il constate.
Et malgré cette aventure, la chasse ne sortira pas de sa vie. Il est même retourné cette année, en béquilles et en véhicule, sans marcher comme avant. Il voulait simplement être là, sentir le bois, revenir à son monde. Chez lui, il montre ses trophées, ses souvenirs, les photos. Il parle du premier qu’il a abattu à l’arbalète quand il était jeune.
Une chose a changé pour toujours. Si à son travail chez Rousseau Métal, il sait qu’à partir de dix pieds il faut harnais, casque, lunettes, système de poulies, il avoue pourtant : « J’ai trois harnais à la maison. Je ne les ai jamais mis à la chasse ». Il en admet l’absurdité : « Si ce jour-là j’avais été attaché, j’aurais probablement simplement viré à l’envers, mais je ne serais pas tombé. » Il le dit sans détour : « Je vais m’attacher. C’est officiel. »
Sylvain Cazes continue de croire que quelque chose l’a protégé, que son père a « arrangé » le scénario, le ménage au sol, le téléphone qu’il avait mis dans la poche de son pantalon plutôt que dans son sac, le fait qu’il soit tombé près de lui, qu’il l’ait vu et pu le saisir, le 911 qui a répondu malgré l’absence de réseau, et la cerise sur le gâteau : lorsque son téléphone a atteint le sol, il a pris une photo. On y voit la jambe de Sylvain, et la plateforme en Y qu’il avait fabriquée. Comme un rappel qu’il doit dorénavant être prudent.
Dans ce mélange de douleur, de métal, de cicatrices et de gratitude, il revient toujours au même point : il est vivant. Debout. Et la prochaine fois qu’il montera, même pour dix pieds, il ne laissera plus jamais la chance décider à sa place.