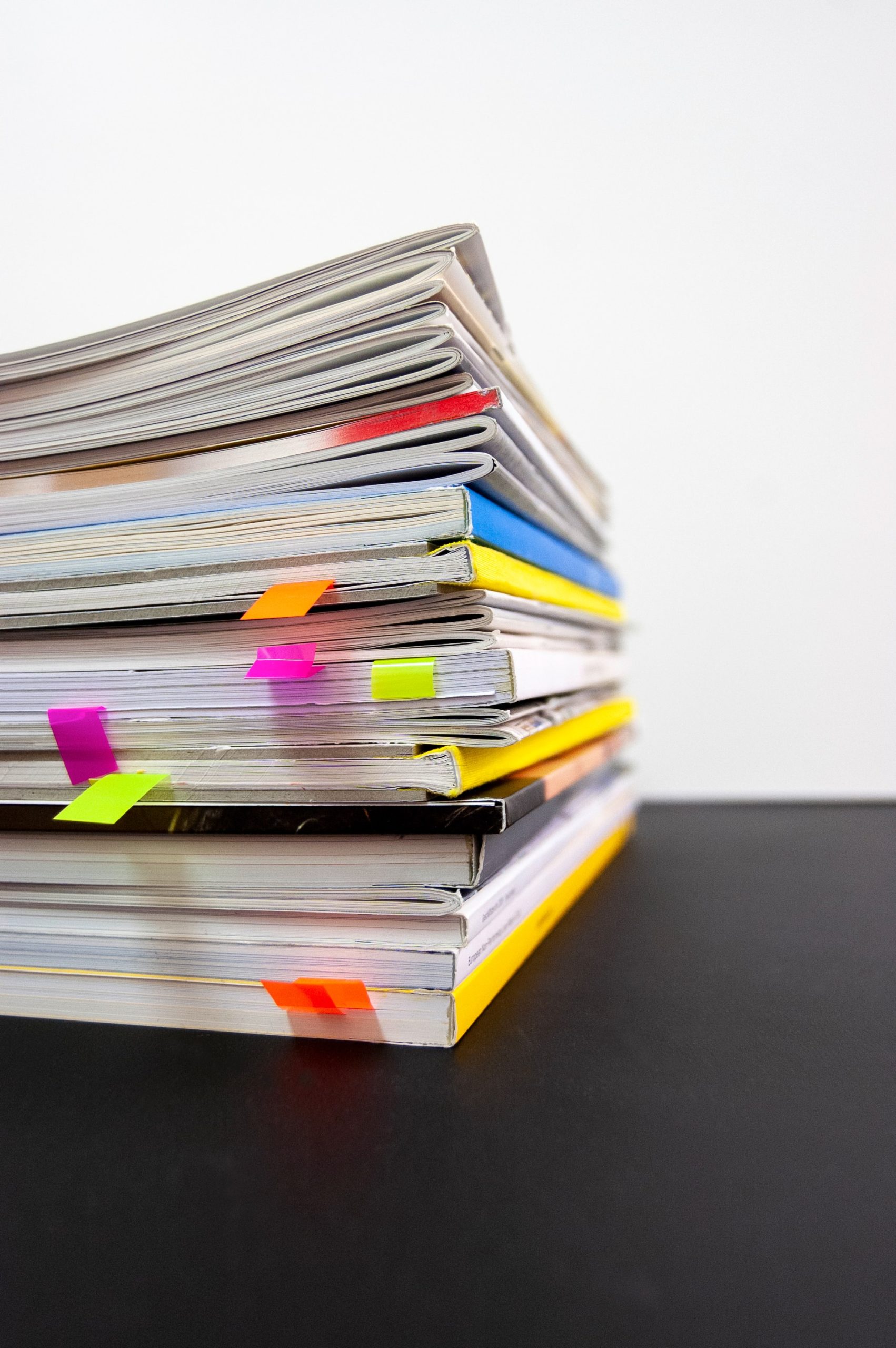Il n’y a pratiquement pas une journée, à la lecture des journaux régionaux ou en glanant sur le web, où il n’est pas question de la fermeture de services de proximité en milieu rural.
Le Kamouraska n’échappe pas à ce phénomène. Encore récemment, les pages du Placoteux rapportaient les difficultés de la Coopérative alimentaire de Mont-Carmel, lesquelles ont finalement conduit à sa fermeture. On se souviendra que la même situation est survenue à Saint-Gabriel, à Saint-André-de-Kamouraska et à Saint-Onésime.
Certes, le gouvernement du Québec a mis en place, dans le cadre du Fonds région et ruralité (FRR), une enveloppe de 10 millions de dollars répartis sur quatre ans (2024-2028) pour appuyer les efforts des élus locaux en vue de contrer la perte de services en milieu rural. Toutefois, il est peu probable que ce fonds soit en mesure d’endiguer les tendances lourdes auxquelles plusieurs localités rurales sont confrontées. Parmi celles-ci, mentionnons la faible diversification économique, la décroissance démographique, le vieillissement accéléré de la population, l’émigration, les conflits d’usage entre certaines ressources, etc. Bien que l’on assiste ici et là à de petites victoires, les histoires à succès s’avèrent trop peu nombreuses comparativement aux pertes qu’ont subies plusieurs localités rurales et petites villes au cours des dernières années.
Devant l’ampleur des enjeux auquel tout un segment du monde rural québécois est assujetti, le temps ne serait-il pas venu de mettre en place des États généraux sur la ruralité, comme ce fut le cas en 1991 ? Quelque 35 ans plus tard, force est de constater que plusieurs localités rurales du Québec sont toujours aux prises avec les mêmes lacunes, ce qui témoigne de l’aspect structurel de la dévitalisation. De plus, certains phénomènes comme les difficultés de recrutement des élus municipaux, ou l’effritement de la solidarité territoriale sont apparus, contribuant ainsi à alimenter ce processus de dévitalisation, et à miner le développement local et régional.
Dès lors, le moment semble propice pour que les intervenants qui gravitent autour du monde rural puissent s’asseoir autour d’une même table afin d’inciter les décideurs publics à déployer des mesures en vue de stopper l’hémorragie liée à la perte des services de proximité. Par ailleurs, si la volonté des élus municipaux est nécessaire pour revitaliser les milieux les plus fragiles, les outils dont ils disposent apparaissent insuffisants pour atteindre cet objectif, compte tenu de leurs multiples responsabilités et de l’étendue des problèmes à surmonter.
Un organisme comme Solidarité rurale du Québec est plus que jamais nécessaire. Mais à plus long terme, c’est toute la stratégie de développement rural et d’aménagement territorial du Québec qu’il importe de repenser. Les milieux ruraux n’ont pas tous la chance de se situer près d’une ville. Une attention particulière doit être accordée à ceux de petite taille démographique, mais aussi à certaines villes devenues fragiles, et ce, dans le but d’améliorer la qualité de vie de leurs résidents.
Majella Simard, Ph. D. en développement régional
Professeur de géographie à l’Université de Moncton
Natif de Saint-André-de-Kamouraska