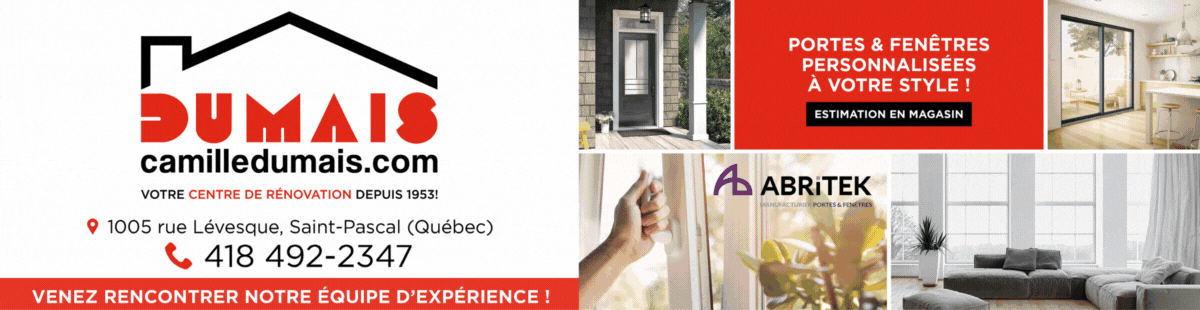En décembre dernier, je déplorais l’absence d’éducation populaire et citoyenne sur le rôle de la fiscalité dans une société comme la nôtre. J’y décrivais l’importance d’instaurer un bas de laine commun pour les dépenses trop grandes pour les individus.
Santé, éducation, transport, énergie, culture, sans une certaine prise en charge par l’État (avec notre argent, ne l’oublions jamais), le citoyen moyen peinerait à assumer seul la facture. Quiconque a magasiné une assurance voyage peut en témoigner : il vaut mieux être riche et en santé que pauvre et malade[1] quand on sort de chez soi sans filet social!
Y en a qui ont toute, pis toutes les autres y ont rien
Change-moé ça, chantait Richard Desjardins. Et effectivement, c’est là où le bât blesse. Parce que malgré l’impôt, on constate que nos sociétés occidentales n’arrivent pas à assurer une certaine équité entre les citoyens. On a beau multiplier les programmes, faire des lois pour protéger les plus mal pris, voter aux quatre ans pour les lendemains qui chantent, on reste muet d’étonnement devant la triste réalité : l’écart entre les riches et les pauvres ne diminue pas.
On sait que sur l’ensemble de la planète, les 1 % des personnes les mieux nanties possèdent presque la moitié des richesses. Ça laisse l’autre moitié à partager entre les 99 % qui restent. On s’en offusque une fois par année, quand les chiffres sortent dans les médias, et puis on oublie.
Pourtant, l’histoire du monde est remplie d’exemples de ce qui se passe quand les riches sont trop riches, et les pauvres trop pauvres. La Révolution française est peut-être le plus connu de ces exemples, mais la Russie, Cuba, l’Inde ont vu leurs peuples se rebeller contre des conditions économiques par trop iniques. Non que ces révolutions aient amené une grande amélioration pour les peuples en question, mais elles démontrent que les inégalités trop grandes suscitent la colère, et trop de colère mène à la révolte.
Même Henry Ford, icône capitaliste s’il en fut, connaissait ce principe. Il affirmait déjà à son époque que pour préserver la paix sociale, un patron ne devrait pas gagner plus de 40 fois le salaire de son employé le moins bien payé.
Jusque dans les années 70, ce ratio tournait autour de 50 pour un, mais la mondialisation de l’économie a complètement déséquilibré le système. Au Canada, en 2023, les 100 chefs d’entreprises les mieux rémunérés (on parle strictement de salaires, ici, sans compter les bonis à la performance) gagnaient en moyenne 246 fois le salaire moyen de leurs employés.
On s’étonne alors moins de la grogne qui se manifeste un peu partout, et de l’engouement pour les discours populistes. L’injustice est réelle, et il est facile d’allumer la mèche du ressentiment en pointant des « coupables » opportunément désignés en fonction d’objectifs plus ou moins nobles. Curieusement, d’ailleurs, on s’attaque souvent à plus pauvre ou plus mal pris que soi. Les ultrariches bénéficient encore de l’aura du succès : on les envie, on ne leur en veut pas vraiment.
Alors plutôt que d’exiger une meilleure répartition de la richesse, on accuse les immigrants de voler nos jobs et nos maisons, on accuse les chômeurs d’être paresseux, on accuse les vieux de coûter trop cher, on accuse les environnementalistes de freiner l’économie… Pendant que les pauvres se battent entre eux, l’élite a beau jeu de faire fructifier son pécule à l’abri des controverses.
Alors, que faire?
Si c’était simple, on aurait trouvé la solution depuis longtemps. Les systèmes économiques d’aujourd’hui sont basés sur la spéculation et le profit rapide. Les transactions boursières se décident en millisecondes par des algorithmes sans états d’âme, avec comme seul objectif la maximisation des rendements. Le bonheur des populations n’entre nulle part en ligne de compte.
Certains ont proposé de plafonner les revenus, comme au hockey. C’est une idée qui n’a pas trouvé preneur. Comme si chacun conservait le secret espoir d’accéder un jour au paradis des riches… autant ne pas risquer de voir plafonner son potentiel, n’est-ce pas? D’autres, dont Michel Chartrand, ont prôné un revenu minimum garanti pour chaque citoyen, de sa naissance à sa mort. Là encore, on a abandonné le projet avant même de l’avoir essayé.
Même les syndicats s’y cassent les dents. Mon amoureux me dit toujours qu’il y a un piège dans les négociations collectives : les augmentations de salaire étant toujours consenties en pourcentage, les plus bas salariés ont beau augmenter leur revenu, l’écart reste tout de même inchangé entre le bas et le haut de l’échelle salariale. Pire, cet écart augmente, parce que la préposée aux bénéficiaires qui reçoit une augmentation de 3 % sur un salaire annuel de 40 000 $ aura 1200 $ de plus à dépenser, alors que l’anesthésiste qui gagne 350 000 $, pour la même augmentation de 3 %, verra son pécule bonifié de 10 500 $. Égalité, oui; équité… pas sûr.
Dans un monde idéal, les syndicats négocieraient les contrats de travail de manière à diminuer les écarts salariaux. Les pauvres recevraient un peu plus, les plus riches un peu moins, pour qu’au bout du compte, les conditions de vie soient meilleures pour tout le monde. Les frais et les tarifs seraient modulés pour affecter riches et pauvres dans les mêmes proportions. Le commerce international serait régulé de façon à ce que les pays riches ne puissent plus prospérer sur le dos des plus pauvres.
Ce monde n’est pas idéal, évidemment. Notre nature avide et égocentrique rechigne à accepter quelque sacrifice que ce soit au nom du bien commun. Nous préférons que la poche aille au plus fort, en rêvant devenir un jour ce plus fort-là, et en restant vaguement convaincu que les pauvres sont responsables de leur sort. Même quand les pauvres, c’est nous.
Nous sommes bizarres…
[1] Merci à Yvon Deschamps pour cette maxime immortelle.