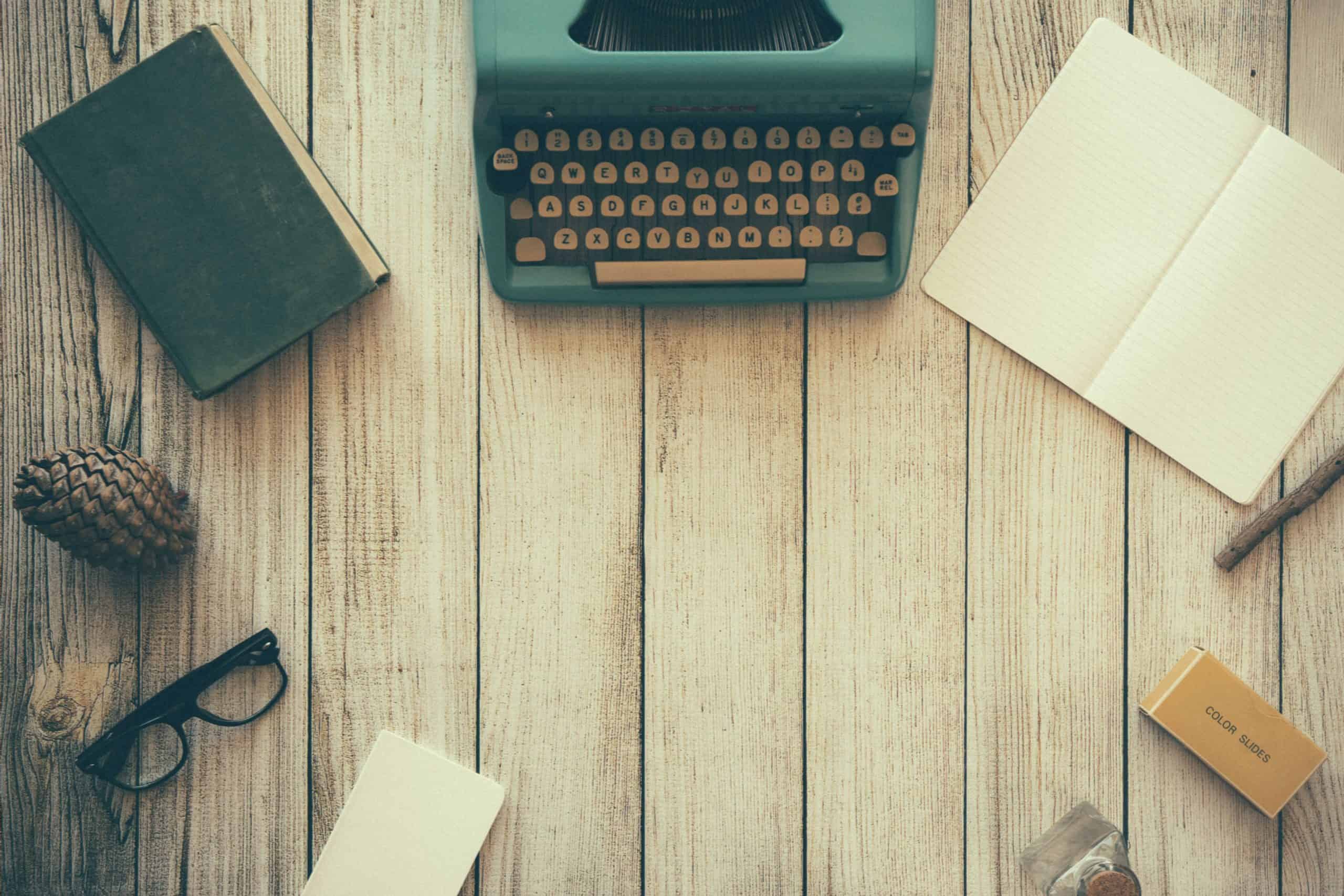Les vacances d’été sont déjà chose du passé. Peut-être faites-vous partie de ceux pour qui, entre deux journées à la plage ou à la piscine, les loisirs culturels ont occupé une place importante.
Lecture, cinéma, musique, balados ou jeux vidéo, un nouveau portrait dressé par l’Observatoire de la culture et des communications de l’Institut de la statistique du Québec montre que ces activités occupent un espace considérable dans le quotidien des Québécois.
Réalisée l’an dernier auprès de 16 000 personnes âgées de 15 ans et plus, l’Enquête québécoise sur les loisirs culturels et le divertissement révèle des pratiques qui reflètent à la fois la persistance des habitudes établies, et l’adoption massive de nouveaux formats en ligne.
Le numérique en tête d’affiche
Sans grande surprise, l’utilisation d’Internet à des fins personnelles est quasi universelle (96 %), et 89 % de la population est active sur les réseaux sociaux. Les 15-29 ans se distinguent particulièrement, avec un taux de présence de 98 %.
Plus de la moitié des Québécois (54 %) jouent à des jeux vidéo, un loisir présent dans toutes les tranches d’âge. Les plus jeunes préfèrent jouer en ligne avec des amis (19 % des joueurs de 15 à 29 ans) et sur console ou ordinateur. Les joueurs plus âgés jouent davantage seuls et sur appareils mobiles.
Les balados sont écoutés par 49 % de la population, mais cette proportion atteint 68 % chez les 15-29 ans, et 63 % chez les 30-44 ans. Les personnes nées à l’extérieur du Québec en écoutent plus souvent (56 %) que celles nées au Québec (47 %). Le revenu influence aussi la pratique, puisque l’enquête démontre que 61 % des ménages qui écoutent des balados ont un revenu élevé, contre 39 % pour les ménages à faible revenu.
Télévision et diffusion en continu
Les abonnements à des plateformes de diffusion numérique non québécoises concernent 73 % de la population, contre 67 % pour la télévision traditionnelle, et 28 % pour les plateformes québécoises.
Chez les 75 ans et plus, la télévision traditionnelle domine (94 %), tandis que 90 % des 15-29 ans et 84 % des 30-44 ans privilégient les plateformes non québécoises. Près d’une personne sur cinq (20 %) passe plus de quatre heures par jour devant la télévision, et 28 % y consacrent de trois à quatre heures.
Musique : une écoute massive mais variée
La musique rejoint 96 % de la population, dont 69 % sont abonnés à au moins une plateforme de diffusion en continu payante. Environ 40 % utilisent ce service presque tous les jours, 35 % écoutent la radio en direct quotidiennement, et 20 % passent par des plateformes vidéo.
Le cinéma constitue la sortie la plus populaire. Le septième art attire 70 % de la population au moins une fois par an. La fréquentation varie selon l’âge, mais ce sont les 15-29 ans qui représentent la proportion la plus élevée, avec 89 %. Suivent les 30-44 ans avec 76 %, les 45-59 ans avec 67 %, les 60-74 ans dans une proportion de 62 %, et finalement les 75 ans et plus qui disent fréquenter les cinémas à 46 %.
Lecture et culture
En 2024, 82 % des Québécois ont lu un livre, papier ou numérique. Les genres les plus prisés sont les romans et nouvelles (36 %), le développement personnel (17 %), et les livres pratiques (16 %). Les jeunes de 15 à 29 ans se distinguent par une lecture numérique plus fréquente (32 %), et une écoute plus élevée de livres audio (21 %).
D’autre part, environ 51 % de la population a visité un musée ou une exposition dans l’année. Les personnes nées à l’extérieur du Québec sont plus nombreuses à le faire (59 %) que celles nées au Québec (48 %). Les bibliothèques publiques, fréquentées par 49 % de la population, jouent un rôle clé d’accès à la culture.
Il est plutôt inquiétant de constater que l’intérêt pour la culture québécoise n’est pas au beau fixe. L’enquête démontre que moins d’une personne sur quatre (23 %) privilégie du contenu télévisuel québécois. Cette proportion tombe à 14 % chez les 30-44 ans, et à 8 % chez les 15-29 ans.
En musique, 69 % des 15-29 ans et 50 % des 30-44 ans écoutent surtout des artistes non québécois, et 57 % des jeunes privilégient l’anglais. Pour la lecture, 37 % choisissent majoritairement des auteurs non québécois.
Les activités culturelles sont plus élevées chez les personnes plus scolarisées ou à revenu élevé. Toutefois, les résultats de l’étude démontrent que les institutions publiques, comme les bibliothèques, contribuent à réduire ces écarts, et à maintenir un accès équitable à la culture à travers la province.